Éducation positive ? Vraiment ?
Quel parent ne souhaite proposer à son enfant un cadre qui lui permettra de devenir un adulte épanoui, capable d’identifier et d’exprimer ses besoins, ses désirs et ses talents ?
Ces 20 dernières années, l’éducation positive a fait son chemin dans nos esprits, jusqu’à devenir une notion incontournable du paysage de la parentalité. Si cette pratique semble aujourd’hui tomber sous le sens, il m’est apparu important d’aller justement la questionner, la scruter dans ses recoins parfois obscurs, pour que celles et ceux qui y ont recours le fassent en connaissance de cause, hors d’une adhésion de principe à ce qui, il faut bien l’admettre, flirte finalement assez souvent avec les injonctions et le dogme.
Pour ce faire, je suis allée à Lyon, rencontrer Béatrice Kammerer, journaliste scientifique, spécialiste de l’éducation.
Épisode #18.155mnL'éducation positive, qu'est-ce donc ?
Comment peut-on définir ce concept et d’où vient-il ? Que propose-t-il pour accompagner au mieux nos enfants et lutter contre les “violences éducatives ordinaires“ ?
Timecodes Épisode #18.1
Épisode #18.262mnEnfant, qui es-tu ?
C’est quoi un enfant, finalement ? Du Moyen-Âge au XXe siècle, chaque époque en a eu sa compréhension et donc sa propre façon d’accompagner cet être à part.
Timecodes Épisode #18.2
Épisode #18.364mnTous neurophiles !
Béatrice Kammerer nous parle culpabilisation, idéalisation… et science. Autant vous prévenir, nos idées préconçues en prennent un coup !
Timecodes Épisode #18.3
Épisode #18.462mnConfusion et bricolage
Ça a bien piqué la semaine dernière et vous saviez en appuyant sur play aujourd’hui que vous pouviez vous attendre à un bain d’orties. Je ne peux vous donner tort, mais rassurez-vous il y aura aussi des choses réjouissantes dans le quatrième et dernier chapitre de cette épique série.
Timecodes Épisode #18.4
Grâce à vos donsGaranti sans pub
L'émission en brefLes meilleurs passages
RessourcesPour aller plus loin
Ressources Épisode #18.1
L'éducation positive, qu'est-ce donc ?
Émergence du concept :
-
Ngram viewer (répertorie l’occurrence des termes dans les livres numérisés sur Google books): https://books.google.com/ngrams
-
Émile ou de l’éducation, 1762, de Jean-Jacques Rousseau (Flammarion, 2009).
-
Recommandations du Comité des ministres aux Etats membres relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive (Conseil de l’Europe, 13 décembre 2006) : www.eurocef.eu
-
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, du Ministère de l’Éducation nationale, décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 (Journal officiel, 2 avril 2015).
-
Réseaux Fonds National Parentalité (anciennement REAAP) de la Sécurité Sociale : https://www.caf.fr/professionnels/offres-et-services/caf-de-la-loire/partenaires-locaux/fonds-national-parentalite
-
Effectiveness of The Triple P Positive Parenting Program on Behavioral Problems in Children: A Meta-Analysis, par Graaf I. et al. (Behavior Modification, mars 2008) : https://doi.org/10.1177/0145445508317134
-
Être parent, une injonction contemporaine, de Claude Martin (Presses Ehesp, janvier 2015).
Fondements théoriques :
-
Les fondements philosophiques de la pensée de Carl Rogers, par Daval René (Approche Centrée sur la Personne, Pratique et recherche, février 2008) : https://doi.org/10.3917/acp.008.0005
-
Parents efficaces, de Thomas Gordon (Poche Marabout, 2013).
-
Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), de Marshall B. Rosenberg (La découverte, 2016).
-
Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, de Adele Faber et Elaine Mazlish (Editions du Phare, 2012, réédition augmentée).
-
La psychologie positive, de Rebecca Shankland (Dunod, 2012).
-
The President’s Address [Annual Report], par Martin E.P. Seligman (American Psychologist, août 1998).
Théories de l’attachement et hospitalisme :
-
L’attachement mère-enfant, par Ainsworth Mary D. S. (Enfance, La première année de la vie, 1983) : https://doi.org/10.3406/enfan.1983.2798
-
Origines et concepts de la théorie de l’attachement, par Dugravier Romain, Barbey-Mintz Anne-Sophie (Enfances & Psy, 2015) : https://doi.org/10.3917/ep.066.0014
-
Pour être un bonne mère, inutile de bondir aux moindres pleurs, par Béatrice Kammerer (Sciences Humaines, août 2019) : https://www.scienceshumaines.com/pour-etre-une-bonne-mere-inutile-de-bondir-aux-moindres-pleurs_fr_41178.html
-
René Spitz décrit des cas d’hospitalisme (1947) : https://www.canal-u.tv/video/cerimes/absence_maternelle_et_traumatisme_de_l_enfance.10347
Éducation à l’école :
-
Bien-être à l’école, de quoi parle-t-on ? par Béatrice Kammerer (Sciences Humaines, mars 2020) : https://www.scienceshumaines.com/bien-etre-a-l-ecole-de-quoi-parle-t-on_fr_42003.html
-
Le bien-être des élèves, par PISA 2015 (Country Note France, OCDE, 2017) : www.oecd.org
-
Promoting positive youth development through school-based social and emotional learning interventions : A meta-analysis of follow-up effects, par Rebecca Taylor et al. (Child Development, juillet 2017).
-
L’enseignement à la loupe, avec Cécile de Hosson (Méta de Choc, juillet 2019) : https://www.metadechoc.fr/podcast/lenseignement-a-la-loupe/
Ressources Épisode #18.2
Enfant, qui es-tu ?
Au Moyen-Âge et sous l’Ancien régime :
-
Au tour des pères d’en baver pendant la grossesse, par Béatrice Kammerer (Slate, avril 2016) : http://www.slate.fr/story/116887/peres-baver-pendant-grossesse
-
L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime, de Philippe Ariès, 1960 (Points, 2014).
-
Histoire des pères et de la paternité, de Jean Delumeau et Daniel Roche (Larousse, 2020).
-
Naître et grandir au XVIIe siècle, le récit véritable d’une sage-femme, de Louise Bourgeois, 1642, suivi du Journal pédiatrique, de Jean Héroüard, années 1601-1602 (Paléo Editions, octobre 2000).
-
Les enfants non baptisés ont-ils droit au paradis ? par Béatrice Kammerer (Slate, avril 2016) : http://www.slate.fr/story/117265/enfants-non-baptises-droit-paradis
Au XIXe siècle :
-
L’école des sages-femmes : naissance d’un corps professionnel, de Nathalie Sage-Pranchère, 1786-1917 (PU Rabelais, 2017).
-
La mortalité infantile en France depuis le milieu du 18ème siècle (INED) : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/la-mortalite-infantile-en-france/
-
Semmelweis, de Louis-Ferdinand Céline (Gallimard, 1999).
-
Prime éducation et morale de classe, de Luc Boltanski, 1977 (Walter de Gruyter, 2018).
-
L’art d’accommoder les bébés, Geneviève Delaisi de Parseval et Suzanne Lallemand (Odile Jacob, 2001).
-
Être un bon parent : une injonction contemporaine, de Claude Martin (Presses de l’EHESP, 2015).
-
Les lois de protection des enfants au XIXe siècle :
– Loi du 22 mars 1841 contre le travail des enfants dans les manufactures : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/loi_22_mars_1841-2.pdf
– Loi du 7 décembre 1874 contre la mendicité enfantine : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_7_decembre_1874.pdf
– Loi Roussel du 23 décembre 1874 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54927363/f468.item
– Loi du 25 juillet 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5493641c/f435.item
-
Jeanne était au pain sec, de Victor Hugo : https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/jeanne_etait_au_pain_sec
-
Histoire des grands-parents, de Vincent Gourdon (Perrin, 2000).
Au XXe et XXIe siècle :
-
Les parents français passent-ils vraiment moins de temps avec leurs enfants ? par Marlène Thomas (L’Obs, janvier 2018) : https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20180108.OBS0297/les-parents-francais-passent-ils-vraiment-moins-de-temps-avec-leurs-enfants.html
-
Interview de Françoise Dolto sur la maltraitance des enfants, par Béatrice Jade (Choisir, septembre 1979) : https://archive.org/stream/FranoiseDOLTOInterviewRevueChoisir1979/Françoise-DOLTO-Interview-revue-Choisir-1979_djvu.txt
-
Une éducation pour une ère nouvelle : le congrès international d’éducation de Calais (1921), par Jean-François Condette, Antoine Savoye (Les Études Sociales, 2016 ) : https://www.doi.org/10.3917/etsoc.163.0043
-
Montessori et la Casa dei Bambini : dimensions idéologique, épistémologique et spirituelle de la méthode, par Serge Franc (Tréma 2018, novembre 2018 : https://doi.org/10.4000/trema.4369
-
Une vie en anthroposophie, avec Grégoire Perra (Méta de Choc, mai 2019) : https://www.metadechoc.fr/podcast/une-vie-en-anthroposophie/
-
Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, de Ferdinand Buisson (Hachette, 1911) : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/
-
Comment aimer un enfant, de Janusz Korczak (Robert Laffont, juin 2006).
-
Convention internationale des Droits de l’enfant (ONU, 1989) : https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
-
J’ai tout essayé, de Isabelle Filliozat (JC Lattès, 2011).
Ressources Épisode #18.3
Tous neurophiles !
Jugement et surresponsabilisation des parents :
-
Être parent, ça s’apprend ? par Fabienne Sintes (Le téléphone sonne, novembre 2018) : https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-22-novembre-2018
-
Devenir mère sous l’œil des autres, par Béatrice Kammerer (Sciences Humaines, février 2018) : https://www.scienceshumaines.com/devenir-mere-sous-l-il-des-autres_fr_39261.html
-
Comment éviter de se fâcher avec la Terre entière en devenant parent, de Béatrice Kammerer et Amandine Johais (Belin, 2017).
-
Soutenir et contrôler les parents ; Le dispositif de parentalité, par Gérard Neyrand. (Recherches familiales, 2012) : https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2012-1-page-187.htm
Reproduction transgénérationnelle des violences :
-
Intergenerational continuity of child physical abuse: How good is the evidence ? par Ilgi Ozturk Ertem et al. (Lancet. Septembre 2000) : https://www.doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02656-8
-
La maltraitance des enfants et le manque de soins de la part des parents ou des tuteurs — Chapitre 3, p75 (OMS, 2002) : https://web.archive.org/web/20210923154507/https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/chap3fr.pdf
-
Un médecin qui estime que les enfants victimes de violence sont les futurs terroristes (France Info, novembre 2018) : https://www.facebook.com/franceinfovideo/posts/2190476330995853
Cadre de développement de l’enfant :
-
Loczy, une maison pour grandir, documentaire de Bernard Martino (Bernard Martino, 2000) : https://www.editions-eres.com/dvd/Loczy-une-maison-pour-grandir-pal
-
Théorie des situations didactiques, de Guy Brousseau (Pensée sauvage, octobre 1998).
Inégalité entre parents :
-
Le partage des tâches parentales : les pères, acteurs secondaires, par Carole Brugeilles et Pascal Sebille (Informations sociales, 2013) : https://www.doi.org/10.3917/inso.176.0024
-
En 25 ans, moins de tâches domestiques pour les femmes, l’écart de situation avec les hommes se réduit, par Layla Ricroch (Femmes et hommes – Regard sur la parité, Insee Références, édition 2012) : https://www.insee.fr
-
Un nouveau travail de “care” conjugal : la femme “thérapeute” du couple, par Irène Jonas (Recherches familiales, 2006) : https://doi.org/10.3917/rf.003.0038
-
Sociologie des enfants, de Martine Court (La découverte, 2017).
Charge mentale :
-
Charge mentale : à l’école aussi, par Béatrice Kammerer (Slate, septembre 2017) : http://www.slate.fr/story/150744/ecole-alourdit-charge-mentale
-
Le congé paternité, un levier d’égalité ? par Béatrice Kammerer (Sciences Humaines, 2019) : https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2019-12-page-34.htm
-
Les pères en congé parental en Norvège. Changements et continuités, par Elin Kvande et Berit Brandth (Revue des politiques sociales et familiales, 2016) : https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2016_num_122_1_3159
-
Avoir des enfants rend-il heureux ? par Béatrice Kammerer (Sciences Humaines, mars 2021) : https://www.scienceshumaines.com/avoir-des-enfants-rend-il-heureux_fr_43147.html
Neuromythes :
-
Pour une enfance heureuse : repenser l’éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau, de Catherine Gueguen (Robert Laffont, 2014).
-
Quelques mythes à propos de notre cerveau, par Elena Pasquinelli (Science & pseudosciences, mai 2017) : https://www.pseudo-sciences.org/Quelques-mythes-a-propos-de-notre-cerveau
-
Les neuromythes, par Marie Gaussel (Institut français d’éducation, septembre 2013) : https://eduveille.hypotheses.org/5698
-
Trop militant•e pour être honnête ? avec Laurent Puech (Méta de Choc, juin 2019) : https://www.metadechoc.fr/podcast/trop-militant-e-pour-etre-honnete/
Ressources Épisode #18.4
Confusion et bricolage
L'ocytocine :
-
Ocytocine et instinct maternel, par Odile Fillod (Gendered neurocultures, juillet 2015) : https://allodoxia.odilefillod.fr/files/2015/07/Fillod_Gendered-Neurocultures_2014.pdf
-
Les hommes, les femmes, Mars et Vénus, avec Odile Fillod (Méta de Choc, octobre 2019) : https://www.metadechoc.fr/podcast/les-hommes-les-femmes-mars-et-venus/
Les fessées :
Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses, par Elisabeth T. Gershoff, Andrew Grogan-Kaylor (Journal of Family Psychology, avril 2016) : https://doi.org/10.1037/fam0000191
Figures d’autorité et pseudosciences :
-
Pour une enfance heureuse, de Catherine Gueguen (Pocket, 2015).
-
J’ai tout essayé, d’Isabelle Filliozat (Lattes, 2011).
-
Le cerveau de votre enfant, de Daniel Siegel & Tina Payne Bryson (Les arènes, 2015).
- Collectif Cocorico : https://web.archive.org/web/20230528184706/https://collectifcocorico.fr/
Dérives :
-
La dérive toxique de la parentalité positive (Les petits ruisseaux font les grandes rivières, septembre 2019) : https://prgr.fr/derive-toxique-parentalite-positive/
-
Aliénation des mères 2.0, adieu. (Soundcloud de Madame Captain, novembre 2020) : https://soundcloud.com/mme_captain/alienation-des-meres-2.0-adieu/
Masculinité toxique :
- Tu seras un homme féministe mon fils, de Aurélia Blanc (Marabout, 2018).
Bricolage éducatif :
-
Yes Day, de Amy Krouse Rosenthal & Tom Lichtenheld (Harper Collins, 2009).
-
L’adolescent est une personne, de Michel Fize (Seuil, 2006).
SuggestionsVous pourriez aussi aimer ...

Médium ou mentaliste ?
L'art de la manipulation mentale nous en apprend un rayon sur nos biais cognitifs et notre vulnérabilité à l’embobinage en règle.

L’amour est-il une valeur sûre ?
Notre société présente la relation de couple comme la chose à vivre.

Bienveillance et scepticisme
Richard Monvoisin, didacticien des sciences, Virginie Bagneux, chercheuse en psychologie sociale, et Élisabeth Feytit parlent bienveillance.

La culture : mère de notre ignorance
La culture n'est-elle pas un nid à idées reçues, à préjugés, un formatage de l'esprit ?





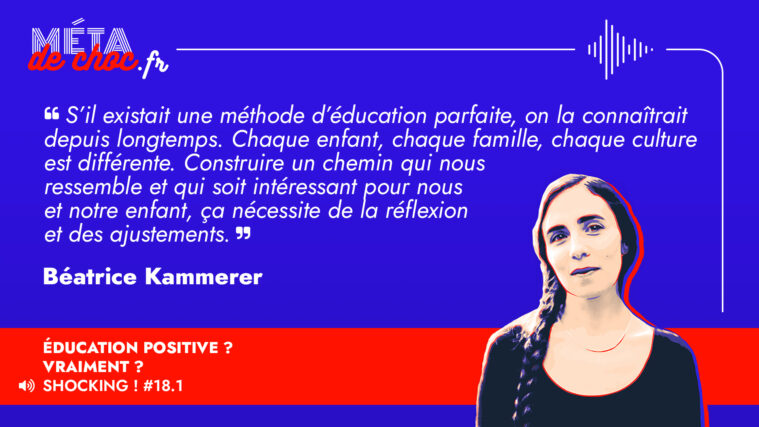
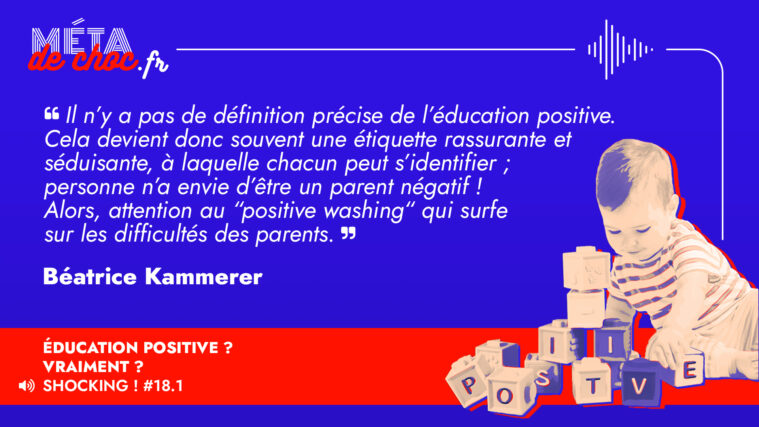
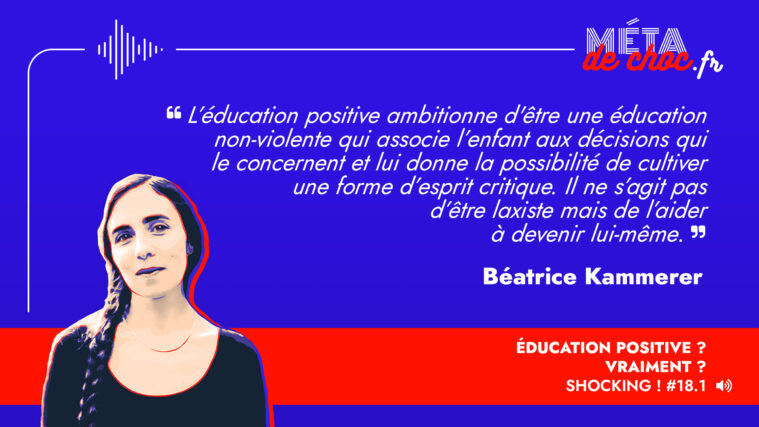
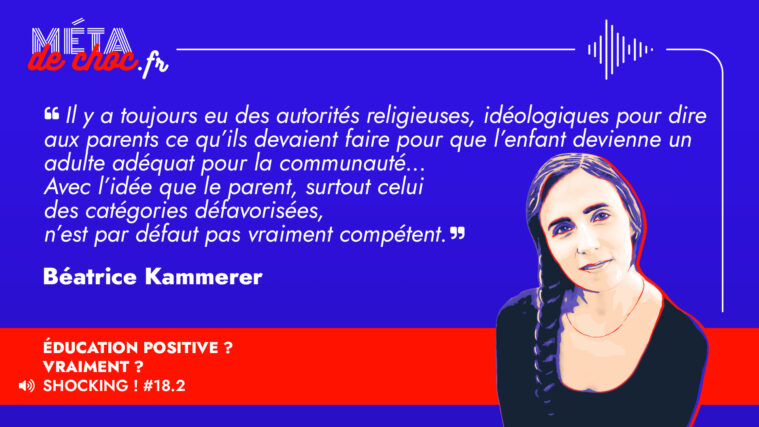
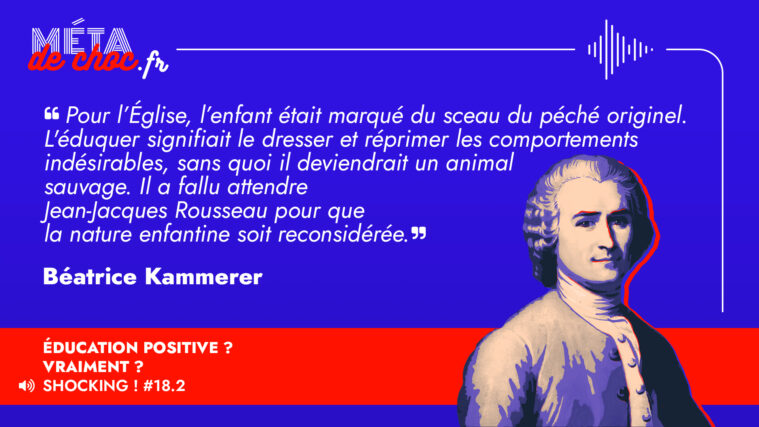
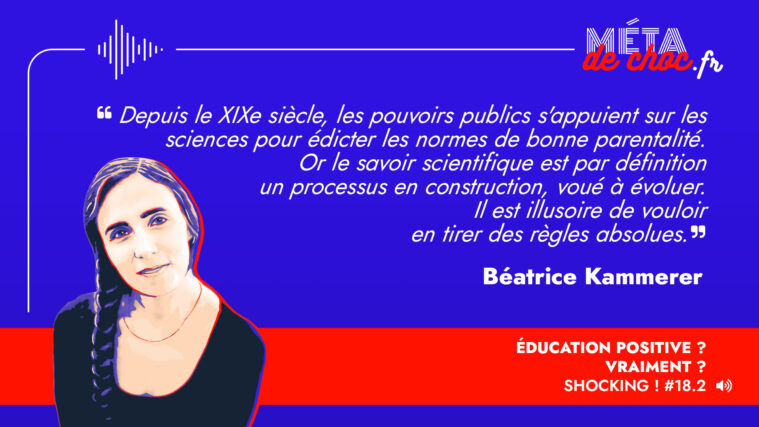
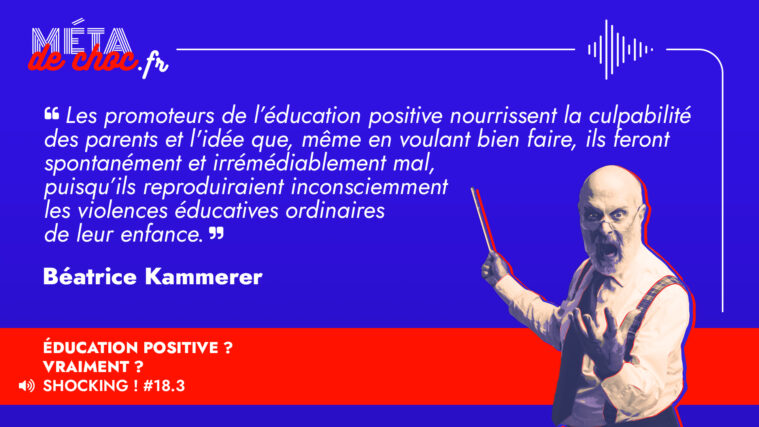
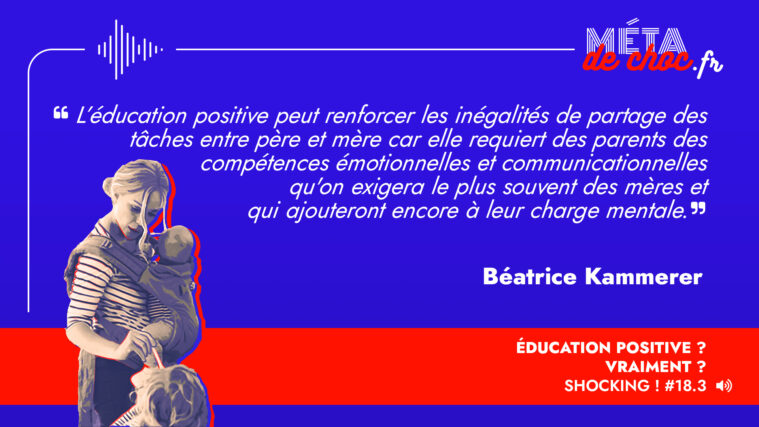
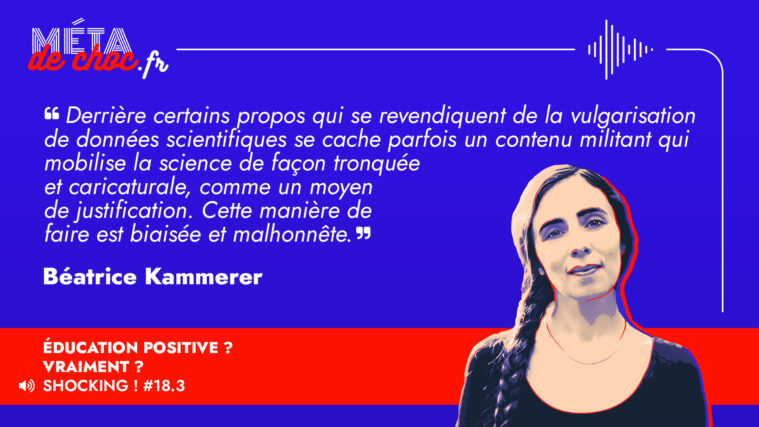
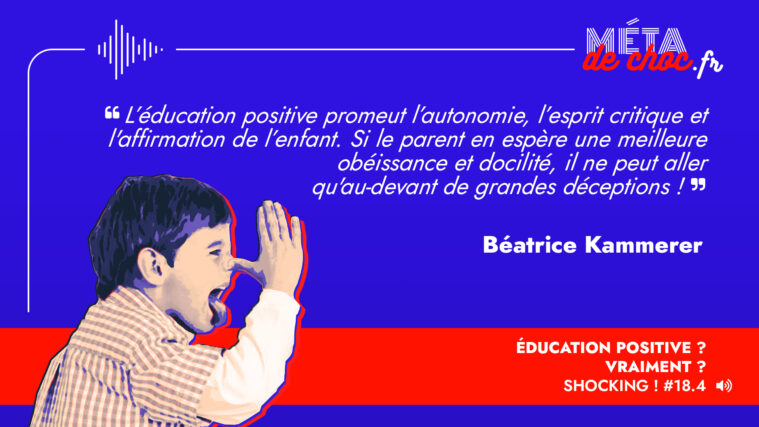
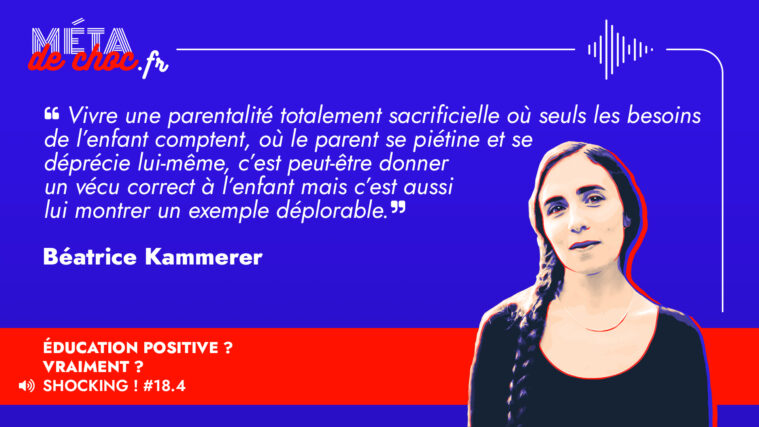
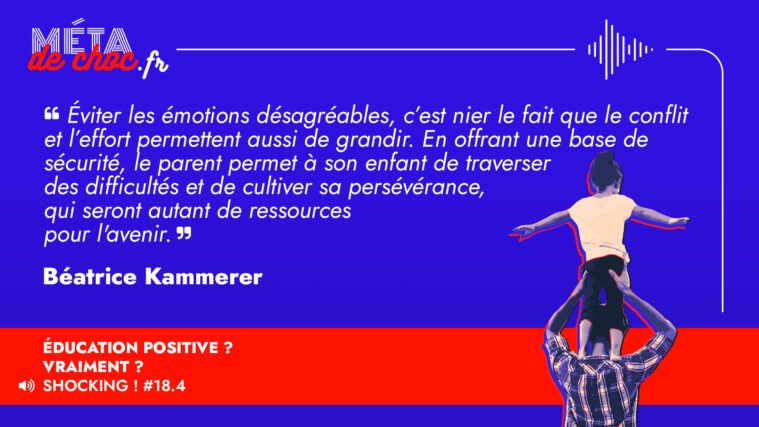

Commentaires (51)